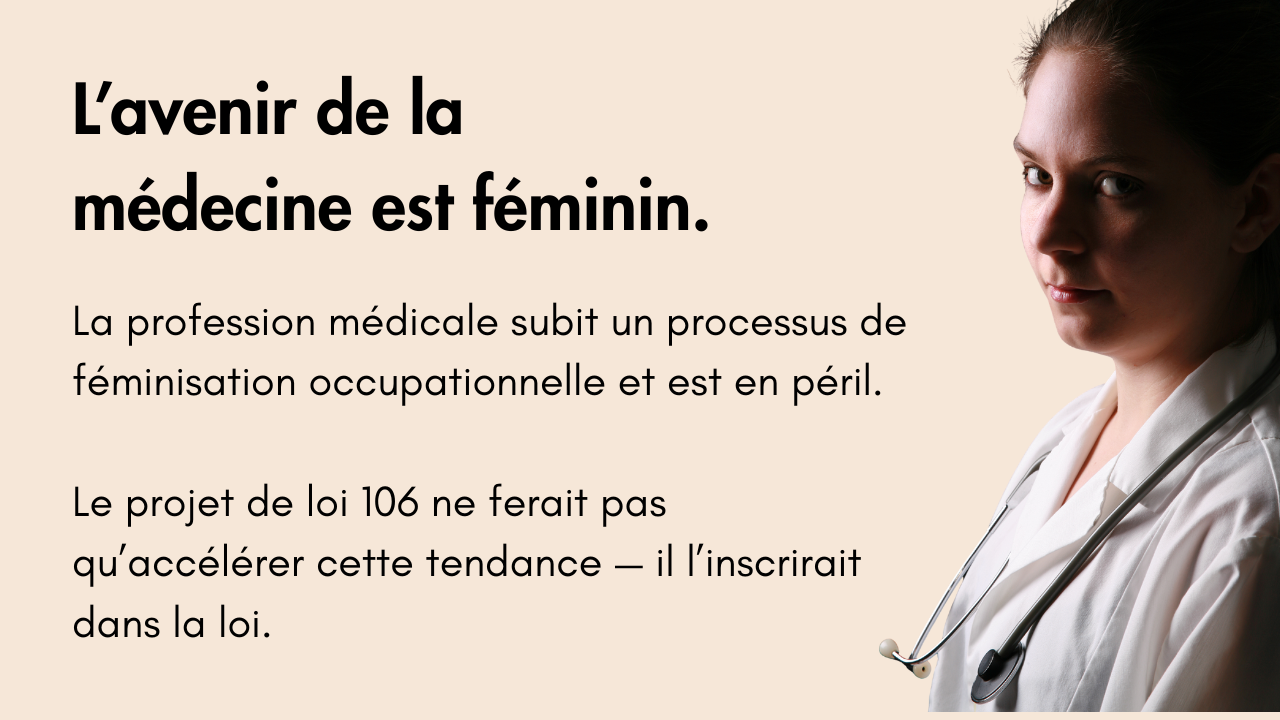Le projet de loi 106 est-il une attaque envers les médecins femmes?
Voyons comment ce projet de loi risque de nuire à la profession médicale — et particulièrement aux femmes médecins.
Aperçu du projet de loi 106, des changements proposés à la rémunération des médecins, et des conséquences imprévues qui pourraient en découler.
-
Le projet de loi s’appuie sur une étude de HEC Montréal qui avance qu’il y a plus de médecins par habitant au Québec que dans d’autres provinces, mais que l’accès aux soins demeure plus difficile.
Les auteurs reconnaissent toutefois la difficulté à définir ce qu’est un médecin à temps plein. Ils optent donc pour la définition de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), soit l’Équivalent temps plein (ETP), une mesure qui reflète davantage la rémunération que le nombre d’heures travaillées.
Selon cette mesure, l’étude affirme que la rémunération des médecins de famille à temps plein (ETP) au Québec est la plus élevée au Canada, une fois le coût de la vie pris en compte.
Mais comme l’ETP est une mesure limitée, les auteurs se penchent aussi sur les données de facturation de la RAMQ — qui sont elles aussi incomplètes, car elles excluent les médecins salariés ou ceux sous un modèle mixte. Ces données sont donc imparfaites.
-
Le projet de loi 106 rendrait jusqu’à 25 % de la rémunération d’un médecin conditionnelle à l’atteinte d’objectifs de performance fixés par le gouvernement, à l’échelle régionale et provinciale.
Quels seront ces indicateurs? Personne ne le sait.
Les 75 % restants seraient répartis selon un modèle mixte en trois volets :
Capitation : un montant fixe par patient, selon son niveau de vulnérabilité.
Horaire : basé sur le temps passé avec les patients.
À l’acte : le modèle traditionnel de facturation.
-
On ignore quels indicateurs seront retenus pour évaluer la performance, ni quelles données les soutiendront.
Le gouvernement pourrait choisir arbitrairement des cibles irréalistes, ce qui lui permettrait d’économiser jusqu’à 25 % de la rémunération des médecins, tout en augmentant le nombre de patients vus.
Ces indicateurs pourraient aussi encourager des comportements contre-productifs.
Par exemple, des consultations plus courtes et superficielles, simplement pour atteindre les quotas.
Autre conséquence imprévue : de futurs médecins pourraient choisir d’exercer dans d’autres provinces. Une perte pour les générations à venir.
À première vue, le projet de loi 106 pourrait nuire à tous les médecins. Mais voyons pourquoi les femmes médecins en souffriraient davantage.
LA FÉMINISATION DE LA PROFESSION MÉDICALE AU QUÉBEC
L’impact de la féminisation n’apparaît pas dans l’analyse purement quantitative de l’étude de HEC, ce que les auteurs reconnaissent. Pourtant, de nombreuses études montrent que les femmes médecins passent plus de temps avec chaque patient.
Des recherches aux États-Unis indiquent qu’elles adoptent une approche plus collaborative et axée sur la prévention et les aspects psychosociaux. Une étude canadienne montre aussi qu’elles offrent moins de consultations par jour, mais y consacrent plus de temps.
Voyons quelques faits et chiffres:
QU’EST-CE QUE LA FÉMINISATION OCCUPATIONNELLE?
Les professions historiquement masculines sont perçues comme techniques, compétitives et prestigieuses. Par le passé, des emplois comme commis ou enseignant étaient bien rémunérés et respectés. Mais à mesure que les femmes y sont devenues majoritaires, leur valeur perçue a chuté. Les salaires ont stagné ou décliné, malgré des exigences scolaires inchangées.
LE CONGÉ DE MATERNITÉ ET « LA DOUBLE JOURNÉE »
L’étude de HEC ne tient pas compte du soin apporté aux patients ni de la charge domestique que portent les femmes.
Chez les résidents en médecine, 98 % des femmes prennent un congé de maternité après la naissance d’un enfant, contre seulement 21 % des hommes. Le régime québécois rend cette inégalité inévitable : les mères (ou parents biologiques) ont droit à 18 semaines, contre 5 semaines pour les pères (ou parents non porteurs). Un partage de 32 semaines supplémentaires est aussi possible.
La RAMQ ne suit aucune donnée sur le nombre ou la durée des congés parentaux chez les médecins.
Même après la naissance ou l’adoption, les femmes restent majoritairement responsables des enfants et du ménage. Cela explique pourquoi elles travaillent souvent moins d’heures et doivent s’adapter à ce qu’on appelle « la double journée ».
Ce concept, introduit par la sociologue Arlie Russell Hochschild en 1989, décrit comment les femmes, même dans des couples à deux revenus, effectuent l’essentiel du travail non rémunéré à la maison — causant fatigue émotionnelle, manque de temps, et ralentissement de carrière.
Selon Statistique Canada, les Québécoises consacrent en moyenne 3,4 heures par jour aux tâches non rémunérées, contre 2,4 heures pour les hommes.
QUELLES SERAIENT LES CONSÉQUENCES POUR LES MÉDECINS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS?
Une conséquence évidente : la baisse de revenus à vie entraînerait une plus grande inégalité de richesse entre les sexes. Cela pourrait aussi exacerber les écarts pour les médecins issus de communautés sous-représentées.
Par exemple, des études américaines montrent que les enfants de première génération issus de l’immigration latino-américaine sont plus susceptibles de soutenir financièrement leurs parents. D’autres recherches révèlent que les jeunes asiatiques et latinos ressentent un fort devoir culturel de soutien intergénérationnel.
Les médecins québécois de première génération peinent déjà à subvenir aux besoins de leurs parents, élever une famille, acheter une maison et rembourser leurs dettes d’études.
COMMENT LES JEUNES MÉDECINS PEUVENT-ILS S’ADAPTER?
Il va falloir repenser vos priorités financières.
Voici comment je m’y prendrais :
-
Les médecins québécois déclarent une dette médiane de 75 000 $ à la fin de leur résidence. Les 10 % les plus endettés dépassent 280 000 $.
Une meilleure stratégie de remboursement pourrait permettre des économies d’impôt et d’intérêts, sans compromettre votre qualité de vie.
-
Il faut revoir l’intérêt de l’incorporation. Si votre revenu baisse, les avantages fiscaux associés à une société peuvent disparaître, surtout au début de la carrière.
Des régimes comme le REER ou le CELIAPP rendent l’incorporation moins pertinente au départ.
Quand les dépenses familiales se stabilisent et la productivité augmente, l’incorporation peut redevenir avantageuse.
-
Avec le Régime d’accès à la propriété (RAP) et le CELIAPP, il devient possible de déduire une bonne partie de son revenu tout en achetant une propriété — sans avoir à s’incorporer au départ.
-
On ne peut jamais parfaitement planifier l’arrivée des enfants.
Prévoyez les coûts associés à l’enfance avant de vous engager dans un achat immobilier, une incorporation ou tout autre projet qui pourrait fragiliser votre budget.